La multiplication des mobilisations et des débats autour du financement de la recherche provoque en ce moment une étrange mise en chiffres de ce monde, d’habitude toujours feutré, où les principales connaissances sont surtout des ragots et des petites histoires, cantonnés à une échelle limitée : celle de son cercle d’amis doctorants, ou celle des quelques séminaires où l’on parle du doctorat (signe des temps, ils se sont multipliés ces dernières années, je pense par exemple au plus connu aspects concrets de la thèse mais les séminaires propres à chaque laboratoire se sont multipliés à vitesse grand V).
En ce moment les chiffres se diffusent et les expériences se partagent beaucoup plus que d’habitude. Mais cette soudaine accumulation de chiffres et de textes de loi, qui s’harmonisent en une grosse et terrible dissonance (en gros rien ne va maintenant, et les perspectives sont pires), a un effet très particulier pour ceux qui sont pris dans ce monde : à force de voir autant d’éléments objectifs qui laissent penser que le monde universitaire est en piteux état, on se demande si on est soi même bien rationnel de continuer à vouloir y faire son trou. Et une question trotte dans ma tête depuis un petit moment à ce propos : est-il bien rationnel de faire une thèse aujourd’hui ? Est-ce que se battre autant pour la financer, se battre ensuite pour la valoriser, et se battre pour qu’elle nous permette d’avoir un poste a un sens alors que les financements diminuent, les postes aussi et qu’il n’y aucune révolution scientifique en ce moment qui soit excitante ?
Il faut bien avouer que l’on réfléchit rarement à sa propre situation et au fonctionnement du monde universitaire en des termes aussi économiques et rationnels, qui permettent de comparer (chose rarement faite) le monde universitaire avec d’autres mondes. Des rationalisations qui sont aussi très violentes à digérer. C’est l’éternel paradoxe des chercheurs qui sont très forts pour objectiver les autres, savent manipuler les données et les chiffres, mais n’aiment pas parler de ce monde universitaire (en plus difficile à saisir en tant que collectif, la recherche étant souvent une compétition individualisée et éclatée au quotidien, à commencer géographiquement puisqu’on ne travaille pas tous au même endroit) ; c’est aussi le problème d’un monde qui se vit sur un autre mode que celui de la rationalité économique : sur la passion, sur la vocation, sur la mission, et sur l’idée que l’on peut vivre d’autre chose que de rationalité froide.
De fait, même si l’on pourrait croire le contraire, les universitaires ne sont pas plus enclins à s’analyser que d’autres métiers : en réalité personne n’aime son reflet dans les statistiques, les textes de loi et les théories sociales, les universitaires pas plus que les autres. Je peux encore sentir distinctement le malaise qu’avait suscité chez moi une lecture de Bourdieu, faisant une description du petit bourgeois en ascension sociale. Se reconnaître là dedans avait quelque chose de terrible.
Bien entendu, aborder l’université et la recherche par ses chiffres, c’est concéder une victoire à Geneviève F. en allant sur son terrain (mais c’est nécessaire pour opposer des chiffres plus réalistes aux chiffres discutables qu’elle manipule) ; c’est concéder aussi que la connaissance relève d’un marché de l’emploi, de l’offre et de la demande, comme n’importe quelle marchandise. Bien entendu, c’est gênant d’un point de vue politique. Collectivement, la seule chose qui nous reste à faire est de se mobiliser. Mais individuellement, la question est tout autre, et rappellera bien évidemment aux initiés le problème du free rider (Olson’ of a b**ch) : suis-je bien rationnel de décider de faire une thèse ? Et même au delà, est-ce rationnel de la continuer une fois qu’elle est commencée ? Compte tenu de l’échec programmé des mobilisations d’universitaires en ce moment, c’est moins la question du salut collectif que du salut individuel qui se pose pour moi comme pour beaucoup d’autres. Et bien entendu l’écrire comme le penser participe de cet échec des mobilisations d’universitaires : mais il devient difficile de croire qu’un sacrifice personnel en vaudrait la peine quand on voit ce qu’il reste à sauver.
La thèse, du hasard à la vocation
Il faut peut-être commencer par souligner à quel point décider de faire une thèse obéit rarement à un calcul, au même titre en fait que beaucoup de choix dans nos vies : le modèle de « l’acteur rationnel » est certes séduisant sur le papier, mais ce genre de décisions est rarissime. On commence sa thèse en étant « élu » par des professeurs, en se sentant poussé à continuer une aventure intellectuelle, et l’on dépose souvent son projet dans l’urgence et l’épuisement d’une fin de mémoire sans trop savoir ce qu’il en sortira (la France ayant cette merveilleuse habitude de faire dériver la thèse du M2, et le statut de doctorant de celui d’étudiant : d’autres pays valorisent au contraire un projet qui aurait muri un peu plus de temps et des gens qui auraient fait autre chose dans leur vie que suivre des cours). On dépose même parfois le mémoire en ayant envie de ne jamais revivre un moment pareil (je ne compte plus combien d’amis doctorants j’ai entendu dire « plus jamais ça, j’arrête là » après le mémoire…). Mais si par hasard il s’agit d’un choix calculé, parions que celui-ci repose en grande partie sur les rétributions symboliques que confère la position d’intellectuel. Personne ne fait ça pour l’argent, et personne n’avouera qu’il a fait ça par hasard, le discours légitime étant bien évidemment celui de « la vocation », outil pratique qui permet de tout tolérer et de tenir le coup.
Pas très loin, de l’autre côté du miroir, on n’est pas plus rationnel, des professeurs choisissent des candidats à la thèse sans vraiment les connaître, un choix basé autant sur la qualité scientifique que sur l’échange de bons procédés entre les professeurs qui sélectionnent (tu as eu l’alloc l’année dernière pour ton poulain, à mon tour de l’avoir cette année), ou parfois sur le fait qu’il y a un ou deux contrats à donner, et seulement un ou deux candidats, sans choix possible. Mais de la même manière que les militaires sont connus pour faire tourner les moteurs des camions à la fin de l’année (il faut bien finir la dotation d’essence), il faut à tout prix attribuer ces contrats.
Lorsque vous commencez une thèse, il n’y a pas de barrière qui vous amène d’un coup à dire « ca y est, je suis rentré dans le marché de l’emploi » (Cf. un des tous premiers articles de ce blog), il y a même, il faut l’avouer, un petit soupir de soulagement à l’idée que l’on évite ce marché de l’emploi qui passe pour effrayant, justement parce qu’on en connaît un peu les chiffres, et que l’on a en tête l’écho de tous les débats sur la précarité des jeunes. Mais pourtant, on est bien devenu un salarié, dans un marché du travail, qu’on s’habitue à ne pas voir comme tel, et dont on supporte les absurdités sans broncher : par exemple le fait de ne presque jamais avoir d’espace de travail et de tout devoir faire avec son propre matériel ; d’être toujours un « junior » même après 6 ans de travail (un coucou à mes amis « consultants seniors » après 2 ans d’expérience) et de devenir crédible seulement après 40 ans ; le fait d’être payé à la fin de l’année plutôt que tous les mois (lorsque vous donnez des cours, ils sont payés à la fin du contrat : bonne chance pour expliquer ensuite à un conseiller Pôle Emploi que vous avez touché le chômage alors que vous étiez légalement sous contrat) ; le fait de devoir demander plusieurs fois de suite à votre université des attestations employeur, qu’il n’envoie jamais systématiquement ; le fait de devoir passer par des prête-noms pour travailler, en étant payé de la main à la main (cf. le dernier article très cru là dessus de rue89) ; le fait d’avoir dans notre monde l’utilisation massive d’un contrat (les « vacations ») qui a été détourné de sa mission première (permettre à des intervenants extérieur de faire cours à la fac) pour permettre à l’université de moins payer une partie de sa masse salariale (et surtout de ne pas payer d’impôts) : tout cela on s’y habitue. Tout cela est douteux, illégal. Tout cela passe comme une série de tracasseries administratives, dans la lignée d’un problème d’inscription comme on en a connu en licence. Sauf qu’on n’est plus étudiant. Un doctorant n’est plus un étudiant, j’insiste, c’est un travailleur dont la carte professionnelle est celle d’un étudiant, c’est tout. Lorsqu’on fait une thèse, on travaille. Et on n’a pas à attendre la fin de celle-ci pour être reconnu comme un professionnel.
On oublie que l’on relève d’un contrat, et du droit du travail, tout comme on analyse rarement le modèle économique propre à notre monde et ses absurdités : il repose par exemple sur le fait de devoir payer pour accéder à ses propres travaux (un récent article a montré le coût exorbitant des abonnements aux plates-formes de revues), de ne jamais être payé directement pour ce que l’on écrit (contrairement à un journaliste), d’organiser des colloques, des séminaires, de participer à des recherches collectives, et là aussi de ne jamais être payé pour : un modèle où aucune tâche ne semble mériter un salaire, et où la seule possibilité d’obtenir de l’argent est d’avoir un poste…ou bien de « faire du terrain », nouveau totem de notre génération de chercheurs : il est plus facile de vous faire financer 6 mois à Honolulu que 6 mois à écrire chez vous aujourd’hui (personnellement j’en suis réduit à artificiellement augmenter les factures, la durée et le coût de ces terrains pour pouvoir vivre ensuite quand j’en reviens, ou bien même à mentir en assurant que j’en ai effectué un). De manière plus anecdotique, ce milieu finance des réceptions somptuaires et d’inutiles colloques à l’étranger, pompant une partie incroyable du budget…où ses précaires viennent récupérer de manière anecdotique ce qu’ils auraient pu avoir de salaire, en jouant discrètement les pique-assiettes.
Sans vouloir à tout prix « monétiser » la pensée, être amené à écrire, publier, organiser des événements, sans être payé, relève pour moi de l’absurde, a des effets psychologiques assez forts (à force vous ne savez plus du tout ce que vous valez), et vous oblige à des contorsions sociales incroyables (vivre dans un taudis mal chauffé mais devoir être présentable comme si de rien n’était à un colloque international, où cette fois ci tout vous sera payé rubis sur l’ongle, bref se priver de l’essentiel pour financer le superflu). Le problème n’est plus que la pensée est devenue une marchandise, mais plutôt qu’avec ce modèle elle ne vaut plus rien.
Ce milieu repose ensuite surtout économiquement et humainement sur un socle de précarité, avec quelques rares élus dont tout le monde espère prendre la place. Un modèle du « winner takes it all » qu’un article récent « How academia resembles a drug gang » avait souligné avec beaucoup d’humour noir. Dans ce modèle, ceux qui ont déjà des avantages attirent les autres avantages. Pensez par exemple aux « primes d’excellence scientifique », qui évidemment vont à ceux qui sont déjà en poste. Et ça n’est pas seulement une question de postes, ça commence à très petite échelle : par exemple, lorsque vous êtes doctorant sous contrat, vous ne payez pas vos frais de scolarité. Autrement dit pour un doctorant non-contractuel, ça veut dire que vous n’avez donc ni salaire, mais en plus l’obligation de payer vos frais d’inscription.
Le livre « les intellos précaires » avait fait connaître il y a quelques années le modèle économique de ce milieu : comme le journalisme, il repose sur une armée de petites mains prolétarisées (mais rarement en contact, rarement conscientes de leur nombre, et dures à mobiliser à ce titre). Si aujourd’hui le milieu universitaire se mobilise contre G. Fioraso, c’est au niveau de ceux qui ont des postes, pas en général : les autres, la majorité, les invisibles précaires, continuent à jouer la même partition, presque sans le vouloir, celle de se battre pour obtenir des avantages avant les autres. Sans voir que statistiquement, le combat est perdu, et que seul l’orgueil, l’aveuglement, et peut-être surtout l’absence d’alternatives et de portes de sortie, continuent à nous pousser à continuer. Faut-il parier sur un retour de la croissance (en général et en particulier dans le milieu scientifique) pour se persuader qu’on n’est pas irrationnel ? Dans tous les cas, s’il est improbable statistiquement d’atteindre la dernière marche du podium, encore moins aujourd’hui qu’hier, tout le monde continuer pourtant à jouer : d’un point de vue d’économiste, faire une thèse aujourd’hui se rapproche d’une partie de poker, dans laquelle on espère gagner en calculant mieux, et dans laquelle de fait on réussit surtout en trichant, en étant celui qui se rapproche le plus des arbitres. Chaude ambiance à prévoir.
La quadrature de la thèse
L’irrationalité de ce que vous faites, vous ne la voyez pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans les yeux de vos ainés, des directeurs de thèse et des professeurs, qui avouent parfois à demi-mot qu’ils ne feraient plus une thèse aujourd’hui, parce que c’est suicidaire, et parce que le monde académique les emmerde. Ou bien vous le voyez même sans qu’ils le disent : la récente biographie d’Olivier Roy est incroyable à ce titre, parce que vous voyez distinctement un autre âge de la recherche, où l’on s’amuse, où tout à l’air plus facile, où l’on est recruté sans avoir été doctorant (je rappelle que Bourdieu n’a jamais fait de thèse), où le monde scientifique est excitant et encore à défricher. A l’époque pas grand monde ne souhaitait être docteur, et le doctorat comme la recherche en général n’étaient pas une fin en soi.
A mon sens la thèse est devenu un ticket d’entrée un peu étrange, devenu obligatoire sans qu’on n’en mesure les effets, et dont l’utilité en tant qu’objet intellectuel compte moins que la tradition de devoir faire une thèse (largement construite, mais qui connaît, honnêtement, l’histoire de ce diplôme ?). Le pire étant que la jeune génération est d’un fétichisme absolu avec ce passage, alors même qu’il devient de plus en plus absurde. Soyons honnêtes, commencer sa carrière par une somme intellectuelle, c’est perdre un temps fou à balbutier sur un type de travail (écrire des centaines de pages et articuler une pensée au long cours) que l’on aurait peut-être gagné à apprendre à faire plus lentement, le long de sa carrière. Un travail qui, statistiquement, passe inaperçu : on n’est quasiment jamais connu pour son travail en thèse (cf. le travail de Stéphane Olivesi sur ce point).
A mon sens, on devrait moins sortir des bouts de thèse pour en publier des articles que prolonger des articles pour en faire une thèse : apprendre à écrire un article scientifique, c’est déjà beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi le milieu des sciences humaines est aussi sensible à la thèse en tant qu’objet littéraire (enfin si, un peu quand même), alors que c’est l’article sur lequel tout repose dans d’autres sciences (la thèse étant un rassemblement de ces articles). Faire des thèses devient en plus absurde puisque le temps pour les lire manque…J’aime les livres, mais je ne vois pas l’intérêt d’en écrire par principe, et pour qu’ils ne soient jamais lus. J’aime la recherche, mais je me m’interroge sur le privilège toujours accordé à la thèse (et plus largement à l’écrit) comme support indépassable.
La thèse aujourd’hui est une situation où il faut gérer l’absurdité d’injonctions contradictoires où, d’une part, le resserrement du marché amène à un sur-travail pour sortir du lot, et, d’autre part, l’obligation croissante de finir les thèses plus rapidement amène à devoir faire ce sur-travail en un temps record : faire plus de colloques, publier plus d’articles, donner plus de cours, lécher plus de bottes. Faire surtout des thèses complexes et spécialisées qui couvrent des espaces d’étude de plus en plus limités, et font de vous moins un « intellectuel » (réfléchissant au cours du monde) qu’un technicien de la recherche vissé à un ou deux sujets très spécifiques. Bref quelqu’un de moins en moins interchangeable et en retour de moins en moins utile dès que l’on sort du milieu scientifique. Mais peut-être est-ce aussi lié à la dépolitisation des universitaires en général (moi y compris), être politisé vous amenant malgré tout l’immense avantage d’avoir une vision un peu globale du monde, et de savoir ce qui se passe autre part.
Un des problèmes de ces injonctions, c’est que le temps manque. Et le temps manque donc pour lever la tête de son travail, et regarder plus loin, par exemple l’évolution du marché de l’emploi académique (baisse des postes, hausse du nombre de candidats chaque année, auxquels il faut ajouter tous ceux qui n’ont pas été pris les années précédentes) ; la dynamique globale du milieu scientifique (où plus personne n’ose proposer de révolutions, ni donner une place à l’imagination, et se contente d’opérationnaliser les théories des grands anciens sur de nouveaux sujets), et particulièrement là dedans le fractionnement assumé des recherches, où vous ne parlez plus qu’à des spécialistes de votre sujet sans se rendre compte que dans la salle d’à côté se tient presque le même discours : jetez un œil à un des premiers colloque de l’Association Française de Science Politique, dans les années 1990. Il y a 6 table-rondes, et quasiment aucune de simultanées. Le dernier congrès comptait en comparaison 66 sections, pour autant de jours. Jetez un œil aussi à cet article coup de poing d’un universitaire facétieux, où l’on aborde frontalement la question de l’inutilité d’un bon paquet d’articles scientifiques.
En comparaison d’Olivier Roy, faire une thèse aujourd’hui, c’est une ascèse, c’est rentrer dans les ordres scientifiques [particulièrement pour ceux qui comme moi, on l’aura compris, n’ont pas eu de contrat doctoral. Commencer dans ces conditions peut paraître encore plus irrationnel, mais j’ai déjà expliqué pourquoi ça ne l’était pas tant que ça compte tenu notamment de l’évolution des modes de financements aujourd’hui]. C’est aussi rentrer dans un milieu hyper concurrentiel : si prompt à critiquer l’économie de marché et la compétition acharnée, le monde universitaire omet pourtant de voir qu’il est moins un bastion de résistance à cet ordre, qu’un parfait exemple de marché féroce, d’autant plus vicieux qu’il ne se donne jamais à voir.
Est-il rationnel d’abandonner ?
Alors que faire ? Si quelqu’un venait me demander aujourd’hui si je conseille de faire une thèse, je lui dirai sans hésitation que non. Quitte à essuyer la question cinglante du « pourquoi tu continues ? », qui se pose bien évidemment en miroir d’une autre, qu’est ce que l’on peut faire autrement ? Ne pas commencer très bien, mais abandonner ? Il faut maintenant renverser la question de départ : est-il rationnel d’arrêter ?
Abandonner, ce serait faire partie de cette armée silencieuse qui chaque année abandonne sans jamais se fendre d’une lettre de démission, sans faire de vagues. Un abandon épuisé et résigné, teinté de honte d’avoir fait partie des perdants, plutôt que de la colère d’avoir fait partie des sacrifiés. Si l’on commence une thèse avec en tête des incitations non-monétaires, on hésite à l’arrêter à cause de la honte sociale que cet abandon ne manque pas de susciter, et plus largement de la « dépendance au sentier », le fait de ne plus vraiment être capable de l’arrêter, l’absence de portes de sortie : à force de fractionnement, le savoir universitaire n’est pas très utile à l’extérieur, d’autant plus quand les entreprises et le monde non-universitaire ont largement développé leur propre manière de se penser (expertise, consultance, théories de RH diverses), d’autant plus quand les partis politiques n’en ont plus rien à faire d’avoir des penseurs avec eux (l’absence de réaction de Fioraso, et le dédain incroyable dont elle a fait preuve avec les universitaires est aussi le symptôme de cette absence de liens entre le monde politique et la recherche aujourd’hui : avec un peu plus de proximité, parions qu’elle aurait au moins essayé d’y mettre plus de formes).
Pourtant, vu ce qu’il nous attend, il va falloir à la fois se mobiliser à l’intérieur de l’université – créer des syndicats de doctorants ? – et se retrouver et se mobiliser entre perdants à l’extérieur de celle-ci. Que vont devenir tous ceux que ce marché universitaire aura rejeté ? Faut-il monter des coopératives de pensée, des boites de consultance, recréer des labos hors les labos, qui récupéreront une partie des recherches par contrats ? J’ai du mal à croire que les modules « professionnalisation » des écoles doctorales, les événements ridicules type « votre thèse en 180 secondes », les séminaires où l’on partage nos expériences sur le doctorat, ou les contrats Cifre vont nous sauver : il serait plus judicieux d’inventer d’autres modèles, et surtout que ces modèles viennent des jeunes chercheurs eux-mêmes.




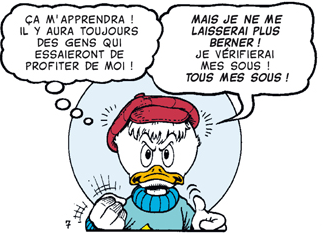



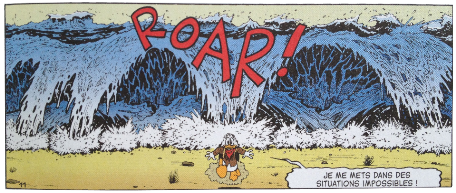


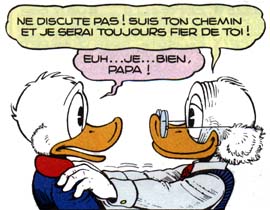
Pingback: A nos fantômes | Histoires à lunettes·